De 2012 à 2016, j’ai participé de très près à la réalisation du DB. J’étais donc tenu à une certaine réserve avant de me joindre au débat. Mais aujourd’hui, une analyse du classement et du rapport annuel lui-même me semble légitime.
J’ai découvert le DB lorsque j’étais conseiller du gouvernement indien, en y cherchant des idées pour alléger la tradition bureaucratique notoirement envahissante de l’Inde. Aussi, lorsque je suis entré à la Banque mondiale et lorsque j’ai appris que je serais chargé de superviser l’équipe du DB, je me suis un peu retrouvé dans la situation de l’habitué d’un restaurant à qui l’on en confierait les cuisines. J’appris donc tout ce qui se passait derrière les fourneaux. Et quoique j’eusse certains désaccords conceptuels, je fus impressionné par l’intégrité qui présidait à la préparation des mets.
Le classement du DB a pour but de mesurer, parmi les pays, la facilité à y démarrer une activité, à obtenir les permis nécessaires, à pouvoir utiliser les infrastructures essentielles, etc. Il repose sur dix indicateurs, dont chacun est lui-même fondé sur différents sous-indicateurs, qui sont compilés, selon une règle fixe, pour l’attribution d’une note finale qui détermine la place du pays parmi les 190 économies considérées. Selon le rapport 2018, la Nouvelle-Zélande et Singapour sont le premier et le deuxième meilleur lieu au monde pour faire des affaires, tandis que l’Érythrée et la Somalie sont les pires, classés respectivement au 189e et au 190e rang.
Si, à certains égards, je n’ai pas apprécié les classements du DB, je ne pense pas que les accusations de manipulations de données soient crédibles. Ayant personnellement supervisé une bonne part du processus, auquel travaille une équipe très nombreuse, qui compile des données provenant du monde entier, je peux attester des multiples échelons de garde-fous qui sont en place.
Il existe néanmoins certaines manières d’influencer les classements sans utiliser de recettes frauduleuses. Dans toute tâche d’envergure, qu’il s’agisse du DB ou de tenter de mesurer un PIB, on découvre, à l’occasion, des défauts conceptuels. Ainsi, lorsque j’ai pris pour la première fois le processus en main, me suis-je opposé à l’hypothèse selon laquelle un niveau élevé d’imposition était forcément mauvais pour l’économie.
Après tout, en suivant cette logique, on aboutit à la conclusion que plus le taux d’imposition est bas, plus il est efficace, et donc que le taux optimal est nul. C’est évidemment absurde. Même si l’on néglige la dimension morale du problème, une fiscalité très basse expose un pays à de graves crises budgétaires, qui sont un cauchemar pour les milieux d’affaires. Des mesures ont donc été prises pour faire les corrections minima, qui ne soient pas cependant trop perturbatrices.
Reconnaître ce genre de problème, c’est pourtant poser un dilemme. Il n’est jamais idéal de changer un instrument longtemps utilisé pour la mesure des évolutions ; mais il n’est pas plus juste de s’appuyer sur une hypothèse dont on sait qu’elle est erronée. Pour ma part, j’ai tenté d’empêcher les biais possibles en ne considérant pas le résultat final sans avoir préalablement décidé, au moyen d’un raisonnement abstrait, quelles évolutions étaient absolument nécessaires.
Dans le dernier exemplaire du DB, les deux grandes controverses concernent la montée de l’Inde dans le classement et la baisse du Chili. Entre 2016 et 2017, l’Inde est passée de la 130e place à la 100e. Je ne suis plus en possessions des informations de première main sur les données, mais je peux discerner deux raisons de cette évolution. Tout d’abord, lorsqu’un pays est déterminé à remonter dans le classement, il peut le faire en concentrant son action sur les dix indicateurs qui déterminent le résultat final, quoique ce ne soit pas la stratégie économique que je préconiserais.
En second lieu, tout changement dans le classement peut être provoqué, soit par ce que fait un pays relativement aux autres pays, soit par des changements dans les mesures utilisées lors d’une année donnée par le DB – comme ceux qui ont été mentionnés plus haut. Ainsi, lorsque l’Inde est passée, entre 2014 et 2015, de la 142e à la 130e position, l’équipe du DB et moi-même avions calculé que quatre places seulement, sur les douze qu’avait gagnées le pays correspondaient à des évolutions réelles qu’il avait réalisées, les autres étant attribuables à des changements de méthodologie.
Quant au Chili, descendu de la 48e à la 57e place entre 2015 et 2016, et qui est aujourd’hui classé à la 55e, rappelons que la compétition en tête du classement est très serrée. De légères évolutions dans des pays qui occupent des positions voisines sur la liste peuvent se traduire par des variations de position assez brutales.
Mais il est aussi vrai que le gouvernement de la présidente chilienne Michelle Bachelet a consacré une plus grande attention aux indicateurs sociaux qu’aux indicateurs économiques. À mon sens, c’est une action louable, et non blâmable. Ayant travaillé avec Bachelet à l’édition 2018 du Rapport sur le développement dans le monde consacré par la Banque mondiale à l’éducation, je sais qu’elle est un des rares responsables politiques sincèrement engagés dans l’amélioration des conditions sociales.
De nombreux pays et dirigeants politiques commettent l’erreur de considérer le classement au DB comme un indicateur général de prospérité. Or le DB ne mesure que ce qu’il prétend mesurer : les facilités accordées aux entreprises. C’est à n’en pas douter important pour une économie, mais ce n’est pas tout. En vérité, l’une des premières leçons de l’économie, c’est que toutes les bonnes choses de la vie nécessitent des compromis. Il serait bien triste de voir un nombre croissant de pays ne plus se préoccuper que de « faire des affaires », sans considérer les autres indicateurs de bien-être.
Traduction François Boisivon
Kaushik Basu, ancien chef économiste de la Banque mondiale, est professeur d’économie à l’université Cornell et directeur de recherche (Senior Fellow) non-résident à la Brookings Institution.
J’ai découvert le DB lorsque j’étais conseiller du gouvernement indien, en y cherchant des idées pour alléger la tradition bureaucratique notoirement envahissante de l’Inde. Aussi, lorsque je suis entré à la Banque mondiale et lorsque j’ai appris que je serais chargé de superviser l’équipe du DB, je me suis un peu retrouvé dans la situation de l’habitué d’un restaurant à qui l’on en confierait les cuisines. J’appris donc tout ce qui se passait derrière les fourneaux. Et quoique j’eusse certains désaccords conceptuels, je fus impressionné par l’intégrité qui présidait à la préparation des mets.
Le classement du DB a pour but de mesurer, parmi les pays, la facilité à y démarrer une activité, à obtenir les permis nécessaires, à pouvoir utiliser les infrastructures essentielles, etc. Il repose sur dix indicateurs, dont chacun est lui-même fondé sur différents sous-indicateurs, qui sont compilés, selon une règle fixe, pour l’attribution d’une note finale qui détermine la place du pays parmi les 190 économies considérées. Selon le rapport 2018, la Nouvelle-Zélande et Singapour sont le premier et le deuxième meilleur lieu au monde pour faire des affaires, tandis que l’Érythrée et la Somalie sont les pires, classés respectivement au 189e et au 190e rang.
Si, à certains égards, je n’ai pas apprécié les classements du DB, je ne pense pas que les accusations de manipulations de données soient crédibles. Ayant personnellement supervisé une bonne part du processus, auquel travaille une équipe très nombreuse, qui compile des données provenant du monde entier, je peux attester des multiples échelons de garde-fous qui sont en place.
Il existe néanmoins certaines manières d’influencer les classements sans utiliser de recettes frauduleuses. Dans toute tâche d’envergure, qu’il s’agisse du DB ou de tenter de mesurer un PIB, on découvre, à l’occasion, des défauts conceptuels. Ainsi, lorsque j’ai pris pour la première fois le processus en main, me suis-je opposé à l’hypothèse selon laquelle un niveau élevé d’imposition était forcément mauvais pour l’économie.
Après tout, en suivant cette logique, on aboutit à la conclusion que plus le taux d’imposition est bas, plus il est efficace, et donc que le taux optimal est nul. C’est évidemment absurde. Même si l’on néglige la dimension morale du problème, une fiscalité très basse expose un pays à de graves crises budgétaires, qui sont un cauchemar pour les milieux d’affaires. Des mesures ont donc été prises pour faire les corrections minima, qui ne soient pas cependant trop perturbatrices.
Reconnaître ce genre de problème, c’est pourtant poser un dilemme. Il n’est jamais idéal de changer un instrument longtemps utilisé pour la mesure des évolutions ; mais il n’est pas plus juste de s’appuyer sur une hypothèse dont on sait qu’elle est erronée. Pour ma part, j’ai tenté d’empêcher les biais possibles en ne considérant pas le résultat final sans avoir préalablement décidé, au moyen d’un raisonnement abstrait, quelles évolutions étaient absolument nécessaires.
Dans le dernier exemplaire du DB, les deux grandes controverses concernent la montée de l’Inde dans le classement et la baisse du Chili. Entre 2016 et 2017, l’Inde est passée de la 130e place à la 100e. Je ne suis plus en possessions des informations de première main sur les données, mais je peux discerner deux raisons de cette évolution. Tout d’abord, lorsqu’un pays est déterminé à remonter dans le classement, il peut le faire en concentrant son action sur les dix indicateurs qui déterminent le résultat final, quoique ce ne soit pas la stratégie économique que je préconiserais.
En second lieu, tout changement dans le classement peut être provoqué, soit par ce que fait un pays relativement aux autres pays, soit par des changements dans les mesures utilisées lors d’une année donnée par le DB – comme ceux qui ont été mentionnés plus haut. Ainsi, lorsque l’Inde est passée, entre 2014 et 2015, de la 142e à la 130e position, l’équipe du DB et moi-même avions calculé que quatre places seulement, sur les douze qu’avait gagnées le pays correspondaient à des évolutions réelles qu’il avait réalisées, les autres étant attribuables à des changements de méthodologie.
Quant au Chili, descendu de la 48e à la 57e place entre 2015 et 2016, et qui est aujourd’hui classé à la 55e, rappelons que la compétition en tête du classement est très serrée. De légères évolutions dans des pays qui occupent des positions voisines sur la liste peuvent se traduire par des variations de position assez brutales.
Mais il est aussi vrai que le gouvernement de la présidente chilienne Michelle Bachelet a consacré une plus grande attention aux indicateurs sociaux qu’aux indicateurs économiques. À mon sens, c’est une action louable, et non blâmable. Ayant travaillé avec Bachelet à l’édition 2018 du Rapport sur le développement dans le monde consacré par la Banque mondiale à l’éducation, je sais qu’elle est un des rares responsables politiques sincèrement engagés dans l’amélioration des conditions sociales.
De nombreux pays et dirigeants politiques commettent l’erreur de considérer le classement au DB comme un indicateur général de prospérité. Or le DB ne mesure que ce qu’il prétend mesurer : les facilités accordées aux entreprises. C’est à n’en pas douter important pour une économie, mais ce n’est pas tout. En vérité, l’une des premières leçons de l’économie, c’est que toutes les bonnes choses de la vie nécessitent des compromis. Il serait bien triste de voir un nombre croissant de pays ne plus se préoccuper que de « faire des affaires », sans considérer les autres indicateurs de bien-être.
Traduction François Boisivon
Kaushik Basu, ancien chef économiste de la Banque mondiale, est professeur d’économie à l’université Cornell et directeur de recherche (Senior Fellow) non-résident à la Brookings Institution.
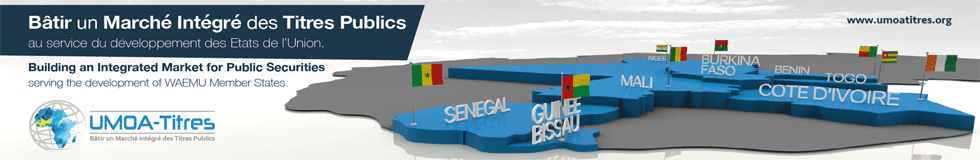


 chroniques
chroniques





























